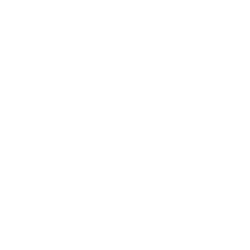Lors d’un contrôle routier le 27 juin 2023, le jeune Nahel Merzouk, à peine âgé de 17 ans, est abattu à bout portant par un policier, dans des conditions encore soumises à enquête du parquet. Une vidéo du meurtre a aussitôt fuité et a circulé sur les réseaux sociaux numériques. Ce fut l’emballement immédiat, et prévisible, tant la scène est choquante et en flagrante contradiction avec la première version des policiers concernés.
Les réactions ne se sont pas fait attendre dans les quartiers populaires. À Melun, les dégâts matériels sont visibles : la cantine du groupe scolaire à Montaigu est HS ; on a pu observer aussi dégradations au niveau de la voirie suite aux véhicules incendiés ; le poste de la police municipale toujours à Montaigu, le centre social Lavoisier, l’espace jeunes de l’Almont, la maison de l’enfance et du mobilier urbain ont été également touchés. Certaines réparations seront longues et coûteuses, et certains services pour les habitants des quartiers du nord de la ville seront durablement entravés.
Telles sont les conséquences matérielles. Cela fait maintenant quelques mois que ces événements ont eu lieu. S’il n’était pas évident de le faire sur le moment, parce que c’est moins audible, nous chercherons à présent à interroger les causes de ce que, du point de vue de l’analyse politique, nous préférons appeler desrévoltes, car elles portent les germes d’une intention politique qu’il faut comprendre afin d’enrayer la spirale de la violence. Nous proposons cette réflexion très située et à approfondir encore plus tard. Notre objectif est de contribuer à la discussion collective, qui nous semble indispensable pour sortir de l’impasse délétère dans laquelle des décennies d’abandon et de ségrégation sociale et géographique ont plongé les quartiers populaires. Plutôt que de condamner moralement en suspendant l’exigence pourtant nécessaire de l’explication des causes, comme l’ont fait l’ancien et puis l’actuel maire de Melun, en surjouant la réponse uniquement sécuritaire, réponse qui prépare les « émeutes » de demain, nous optons pour une combinaison raisonnée du diagnostic et l’explicitation d’une stratégie d’intervention qui prône l’action sur les racines du trouble et, au plus vite, la désescalade contre le tout-sécuritaire et la surenchère de l’ordre quai martial, sans justice ni pacification de la société. C’est une esquisse bien sûr, un premier billet sur ce blog : on aura d’autres occasions de revenir sur cette question.
Brûler des services publics ?
Un constat tout d’abord. Melun, comme beaucoup de villes ayant connu des révoltes de même type, se distingue par un profil social défavorisé de ses Quartiers en Politique de la Ville (QPV) : pauvreté et chômage principalement chez les habitant·es issu·es de l’immigration et les jeunes adultes, trafics de drogue, logements sociaux dégradés, voire carrément indignes, descentes régulières et ciblées des polices nationale et municipale… Le sentiment de relégation et d’abandon de la jeunesse ainsi que celui d’une discrimination ethno-raciale, que ce soit par les politiques, les autres habitant·es des quartiers plus privilégiés ou les « forces de l’ordre » enferme les habitants toujours un peu plus dans l’enceinte étriquée de la différence et la peur du monde exterieur – qui leur paraît hostile ou inatteignable. On assiste à une ségrégation de fait, visible matériellement, car nombre de familles immigrées et précaires n’ont accès qu’à des logements HLM, dont le maillage est surtout concentré sur les pourtours des villes ; à Melun, c’est principalement dans le nord. Cela construit des frontières sociales, cela contraint les déplacements mais aussi plus largement l’espace des possibles offerts aux populations. La jeunesse de ces quartiers, notamment celle qui s’est révoltée, est principalement en âge de fréquenter des collèges et lycées. Elle a accès, via les réseaux sociaux numériques, à l’information du monde qui l’entoure ; elle se sent toujours plus en décalage avec ce que le monde donne à voir, en particulier les médias dominants dont la frange extrémiste de droite construit la diversion et l’emballement par les faits divers et la stigmatisation des mêmes populations (le reportage en direct du « journaliste » pédocriminel J.-M. Morandini à l’Almont, le 7 septembre 2023, pour la chaîne CNEWS, appartenant au milliardaire réactionnaire Bolloré, en fut la caricature glauque). Une étude d’une équipe de SciencesPo menée par Marco Oberti permet de prendre du recul factuellement : « dans les banlieues parisiennes, 73 % des villes en QPV ayant eu une émeute ont une école défavorisée, contre 43 % des villes QPV n’ayant pas eu d’émeutes ». Voici déjà un élément à retenir : la ségrégation scolaire, que nous connaissons bien dans notre ville, où la majeure partie des écoles publiques sont en REP et se distinguent par des Indices de Positions sociale faibles, se voit accentuée par une fuite vers les écoles privées (sous contrat, donc financées par tout le monde) des familles majoritairement bourgeoises et favorisées.
Nombre de représentant·es politiques et d’éditorialistes parisiens ont montré leur incrédulité devant le fait, ont condamné en bloc, sidéré·es par ce que certain·es qualifient d’« ensauvagement » ou de « décivilisation » (des emprunts terminologiques à l’extrême droite, l’air de rien), que ces jeunes « émeutiers » s’en sont pris à des écoles, des centres sociaux ou des équipements publics de leurs propres quartiers. On le regrette, c’est certain, mais il faut prendre au sérieux le message : ces lieux, à commencer par l’école, représentent une faillite toujours plus insupportable pour des jeunes en rupture de ban. Ce fut la même logique lors des révoltes dans les banlieues en 2005, qui engendrèrent d’ailleurs les mêmes lamentations qui ont justifié la même stratégie du choc pour mater les « émeutiers » à coup de Kärcher (c’est le slogan d’un ancien ministre de l’Intérieur, puis président de la République, par ailleurs modèle de probité dont les affaires de corruption diverses font encore aujourd’hui l’actualité judiciaire). Brûler des écoles ? Rien n’est plus explicable, soulignent Didier Chabanet et Xavier Weppe en 2017 dans la Revue française d’administration publique : « L’un des piliers de la République française, celui qui promeut l’égalité des chances entre tous, quel que soit leur statut social ou leur origine, est accusé de les avoir rabaissés, écrasés, rejetés, méprisés, compromettant presque définitivement la perspective d’un avenir meilleur. Ce ressentiment est d’autant plus exacerbé que le pays a fait de l’ascension sociale au travers du système scolaire, au mérite et par le travail, l’un des mythes fondateurs de son histoire commune. » Le phénomène paraît illustrer une tendance, mais il n’en rien : des lycées ont brûlé dans les années 70 pour des raisons analogues, comme l’a rappelé l’historienne Laurence De Cock. On ne s’étonnera pas non plus que les bibliothèques soient également brûlées. Et là aussi, ça n’est pas nouveau. Entre 1996 et 2013, 70 bibliothèques ont été incendiées, comme l’a rappelé le sociologue Denis Merklen en 2013. Il faudrait actualiser les chiffres 10 ans plus tard, mais son analyse demeure pertinente : ces équipements publics, très peu fréquentés par les habitants, sont perçus par les jeunes « émeutiers » comme un prolongement des logiques scolaires ségrégatives sous prétexte d’émancipation par le savoir, un vecteur d’exclusion et au final un lieu-sanctuaire mais repoussoir de la culture écrite. « Les incendies des bibliothèques, souligne D. Merklen, nous renseignent sur la politique des bibliothèques et sur la place de l’écrit dans nos sociétés, mais ils nous renseignent surtout sur l’évolution d’une démocratie qui observe presque impassiblement comment se creusent les fractures sociales qui séparent ses citoyens en classes. Ces incendies sont des messages adressés aux hommes politiques et aux militants, aux gens de la culture et aux gouvernants. Ils tentent de faire entrer dans l’espace public ce que d’autres cherchent à en faire sortir. Ils visent l’action et le débat contre l’inaction, la relégation et l’oubli. On comprend mieux ainsi la nature politique d’un conflit où les formes nous effraient, mais où ce qui est en jeu est la manière que nous avons de nous organiser pour vivre ensemble. » C’est en cela, on l’aura compris, que ces « émeutes » sont plus que des mouvements d’humeur : des révoltes politiques.
On pourrait élargir à d’autres services publics pris pour cibles. On peut évidemment déplorer l’image renvoyée au reste du monde, celui du dépit, de la tristesse et de la rage face à la relégation et l’ostracisation de leur cadre de vie, leurs possibilités d’évolution et leurs conditions d’apprentissage, pour lesquels les budgets sont de plus en plus réduits, les perspectives d’évasion et d’évolution sociale de moins en moins visibles, et les culpabilisations, les condamnations, elles, de plus en plus présentes. Pourtant, on ne peut pas faire comme si rien n’avait été diagnostiqué pour faire dévier de son cours la politique de la ville dans un sens plus juste. Des initiatives portées notamment par l’« Association Collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble, Unis » (ACLEFEU) ou la coordination nationale Pas sans Nous ont renouvelé l’appréhension de ces questions et ont suscité l’espoir sur la base de diagnostics et de mise en partage des expériences critiques. Mais il faut croire que cela ne suffit pas, à tout le moins : tant que ce sera le business as usual au sommet du pouvoir, l’alternance entre les grandes proclamations incantatoires et le vide de propositions, les révoltes apparaîtront à la prochaine circonstance qui le facilitera.
Un gouvernement pas à la hauteur
La réponse du gouvernement, en attendant, n’est pas à la hauteur. Pire, elle jette de l’huile sur les braises. La Première ministre Élisabeth « 49.3 » Borne a annoncé la couleur lors d’une conférence en Sorbonne le 26 octobre 2023, devant 500 élu·es (dont M. Mebarek, néo-maire de Melun qui a visiblement compris le message) : face à la dépression, le gouvernement opte pour la répression des jeunes et la pression (par la culpabilisation morale, les sanctions) sur les parents. L’autoritarisme macroniste s’autorise d’une vision extrême-centriste de l’Ordre, de la Discipline et de la Raison : mater les populations défavorisées et pauvres pour les faire « cheminer » de façon droite et soumise. Comme Mme Borne embrasse la politique du « en même temps », un volet « social » est également mis en avant, incluant de la médiation sociale et des mesures ciblées (lutte contre la discrimination à l’embauche, par exemple), mais c’est flou, sous-financé, non hiérarchisé et de l’ordre de la promesse déjà oubliée. Sur le plan de la construction de la réponse gouvernementale, on est loin de la fiction du « Grand Débat », visant à intégrer les points de vue à la base. Après avoir annoncé un travail parti du terrain, à savoir une consultation des maires, et non pas des mères, et non pas des habitant·es des quartiers prioritaires, ont été annoncées dès l’été, mais la réponse « en profondeur » est, comme d’habitude avec ces gouvernements macronistes, insuffisants et questionnables.
Plus précisément, les voici, ces grandes décisions. S’auto-félicitant d’avoir augmenté les moyens du ministère de l’Intérieur « à des niveaux sans précédent » depuis 6 ans, le gouvernement annonce le doublement de la présence des forces de l’ordre sur la voie publique d’ici à 2030. Or les effectifs ont d’abord été lourdement réduits sous l’ère Sarkozy puis celle de Hollande, comprenant la suppression de la police de proximité et la création de la BAC, aux missions souvent tournées vers les trafics, mais aussi les personnes racisées. La police actuelle est soumise à des quotas, et on comprend bien les dérives que cela induit : contrôle au faciès, descentes dans les quartiers, contrôles rapides et sans humanité, surveillance à distance, etc. Pour rassurer les maires, le président Macron propose maintenant à la Police municipale de prendre toujours plus le relais, en lui donnant la possibilité d’accomplir certains actes de police judiciaire. C’est la fuite en avant sur ce plan-là comme tant d’autres. La montée en puissance des PM dans ce registre, avec force shérif et ambiance western, n’est pas une bonne chose. Et c’est la perspective d’un craquèlement de l’action publique par les inégalités territoriales entres communes riches et moins dotées, où le désengagement progressif de l’État et ses services régaliens (Police nationale) est compensée par des forces de l’ordre à la solde de maire qui se rêvent pour certains en premier flic de leur cité. Feu la police de proximité, le travail de terrain qui prend du temps, mais qui est tellement plus productif et reconnu par les populations, avec lesquelles il faut se lier à nouveau.
Toutes les réponses proposées par le gouvernement Borne constituent autant de pansements sur une jambe de bois : couvre-feux, pénalisation des parents qui, souvent, sont eux-mêmes démunis face à la dérive de leurs enfants, etc. Beaucoup travaillent dur et loin de leur domicile pour nourrir leur famille, et ils ne peuvent assurer un temps de présence suffisant auprès de leurs enfants. Le gouvernement propose également d’étendre le Service National Universel, cette brigade patriotique et contestable, à l’uniforme kitsch et à la discipline façon Les Choristes. Renforcer le rôle de l’école est aussi au menu de ce repas de fast-food politique, mais c’est à la portion congrue : alors que cette institution tellement essentielle dans la formation et l’émancipation de la jeunesse a été détruire méthodiquement depuis des années, épuisant des enseignant·es sous-payé·es et maltraité·es, on lui demande la Lune. La réponse, si peu budgétée, ne pourra pas changer l’existant. L’action publique façon start-up nation découvre les ruines de décennies de politiques inefficaces. Les solidarités collectives ont été rongées et il faut relancer la machine de presque zéro. Dans nos villes, il n’y a plus de psychologues, d’assistants sociaux, les habitant·es ont tellement de mal à contacter la CAF, les CCAS débordent, les centres sociaux ont peine à honorer leurs services de base, etc. Le temps de l’adolescence est de moins en moins pris en compte : que sont devenues les MJC ? Que peuvent faire nos jeunes pour occuper leur temps libre disponible, sinon se réfugier derrière leurs écrans ou traîner au pied des bâtiments ? Souvent, le sport est un lieu ressource, un exutoire et la source d’un divertissement salutaire, mais il demeure encore trop coûteux pour de nombreuses familles. L’offre d’activités culturelles est pauvre, voire inexistante, tant elle se concentre dans les quartiers favorisés.
L’État décide donc que les parents sont seuls responsables du devenir de leurs enfants. Cela est en effet bien plus commode que de réfléchir à ses propres échecs, de la manière dont les cités sont devenues, pour certains, des lieux de relégation et cibles abstraites de politiques publiques gouvernées à distance par des bureaucrates épuisés.
Et à Melun ? C’est, à peu de chose près, le décalque de l’impotence du pouvoir d’en haut. La première grande résolution de Kadir Mebarek ? 300 000 euros fléchés in extremis dans l’installation d’une antenne de la police municipale proche de la gare. Pour le reste : les mêmes rengaines sécuritaires qui étaient celles de Louis Vogel, vaguement mâtinées de médiation sociale en sous-traitance. Pour le reste, c’est le calme plat.
***
Il faut planifier la réparation du lien social et le faire sur le temps long : pas durant un quinquennat ou à coup de propositions-chocs déjà oubliées, mais à l’échelle d’une vie, des vies des habitant·es de nos quartiers populaires. Il faut inverser le paradigme : que chaque enfant, chaque citoyen.ne en devenir puisse se sentir accueilli·e, libre et encouragé·e dans ses choix et ses désirs, quelles que soient les origines sociales, d’où qu’on naît. Sur ces points, nous ne partons pas de rien. Hors de question de réinventer la roue. On se permettra de renvoyer, d’une part, aux propositions insoumises concernant l’exigence d’égalité républicaine dans les quartiers populaires ; d’autre part, celles concernant la jeunesse, qui doit pouvoir aspirer à un exercice plein de la citoyenneté, à l’autonomie, à des emplois qualifiés qui permettent de vivre et travailler dignement, mais aussi, à l’épanouissement ; enfin, puisque la question sécuritaire est forcément mentionnée comme prioritaire des débats sur les « émeutes », eh bien soit, on pourra se reporter utilement aux propositions relatives à la refondation d’un service public de la police. Tout cela doit aider à la construction et au partage des bonnes idées pour sortir de l’ornière, et n’a certes pas vocation à être appliqué tel quel. Ce sont des lignes de force politique, fruit d’un travail de constat antérieur et élaboré par des actrices et acteurs en prise directe avec ces réalités. Il ne tient qu’à nous d’actualiser ces orientations à Melun, dans nos milieux de vie, dans des quartiers qui méritent mieux que ces saupoudrages d’aides publiques et ces discours sécuritaires.
Cécile Prim & Arnaud Saint-Martin
Image en bandeau : cliché interchangeable de voiture en flammes, ici à Strasbourg en 2005, via Wikipédia.